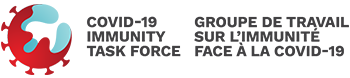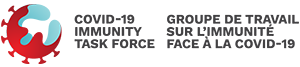Surveillance des vaccins

Le Réseau national canadien pour l’innocuité des vaccins (CANVAS)
Julie Bettinger, Université Dalhousie
Depuis 2009, le Réseau national canadien pour l’innocuité des vaccins (CANVAS), qui fait partie du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), effectue une surveillance active de l’innocuité des vaccins. En utilisant ce cadre existant, les chercheurs surveillent l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 dans l’ensemble du Canada.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 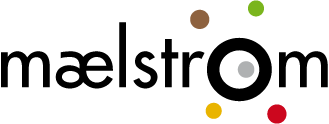

Caractérisation de l’épidémiologie de la sécurité du vaccin contre la COVID-19 et détection des signaux de sécurité pour les effets secondaires après l’immunisation en Alberta
Alexander Doroshenko, Université de l’Alberta
Cette étude vise à renforcer la capacité existante du système de santé publique de l’Alberta à consigner et à étudier les événements indésirables après la vaccination contre la COVID-19. Les chercheurs étudient spécifiquement les événements indésirables chez des personnes telles que des autochtones et des personnes issues de milieux économiquement vulnérables, pour lesquelles il peut être difficile d’obtenir des renseignements fiables.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 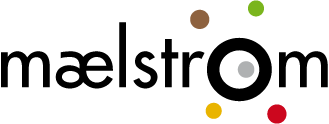

Suivi de la réponse immunitaire dans le contexte de la vaccination contre la COVID-19 – Mise en place d’une cohorte longitudinale de donneurs de plasma
Marc Germain, Héma-Québec
Compte tenu du grand nombre de gens qui donnent régulièrement du plasma, nous avons lancé une biobanque d’échantillons. Les échantillons de plasma nous permettent de recueillir des informations avant et après la vaccination, et parfois avant et après l’infection, afin de permettre à nos chercheurs et à d’autres chercheurs au Canada d’étudier la réponse immunitaire à la vaccination ou à l’infection.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 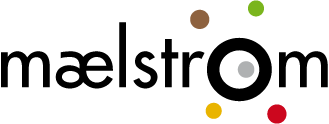

Études post-commercialisation des vaccins contre la COVID-19 du Réseau de collaboration provinciale (RCP) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)
Jeff Kwong, Université de Toronto
En utilisant des bases de données dans cinq provinces, notre étude vise à estimer la couverture vaccinale contre la COVID-19, à déterminer si les personnes vaccinées sont plus susceptibles de subir des effets indésirables que les personnes non vaccinées, et à évaluer l’efficacité de différents vaccins et de différents calendriers de dosage, ainsi que la durée de la protection.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 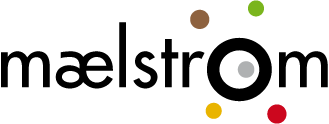

Immunogénicité et effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) avec des calendriers alternatifs de vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada : le « mélange » de la deuxième dose (MOSAIC-1) et d’une troisième dose hétérologue (MOSAIC-2) est-il sûr et immunogène?
Joanne Langley, Université Dalhousie
Cette étude suit des participants dans six provinces pour déterminer la sécurité et l’efficacité de la combinaison de différents vaccins (mélange de la deuxième dose), ainsi que pour déterminer les effets des différents intervalles de dosage utilisés au Canada sur l’immunité et l’innocuité.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 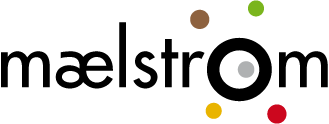

Meilleures pratiques pour les études en réseau distribué sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins
Robert Platt, Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Ce projet est axé sur l’élaboration et la mise en œuvre de solutions aux problèmes méthodologiques qui se posent dans les études relatives à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins. L’objectif est de soutenir les organisations et les chercheurs en utilisant la bibliothèque existante de méthodes pour l’innocuité et l’efficacité des médicaments et de développer des pratiques recommandées pour les études sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins dans les réseaux distribués.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 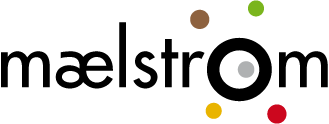

Optimisation de l’immunisation contre la COVID-19 chez les patients présentant des effets secondaires suivant l’immunisation et les patients immunodéprimés dans le réseau de cliniques spécialisées en immunisation
Karina Top, Université Dalhousie
Le succès des campagnes de vaccination massive contre la COVID-19 dépend de l’évaluation continue du profil de sécurité et de l’efficacité des vaccins. Cette étude vise à aider les agences de santé publique à normaliser l’évaluation et la prise en charge des patients présentant des effets indésirables inattendus, graves et rares suite à l’immunisation (AEFI) aux vaccins COVID-19.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 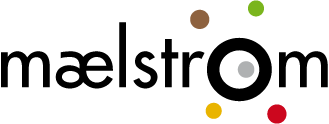
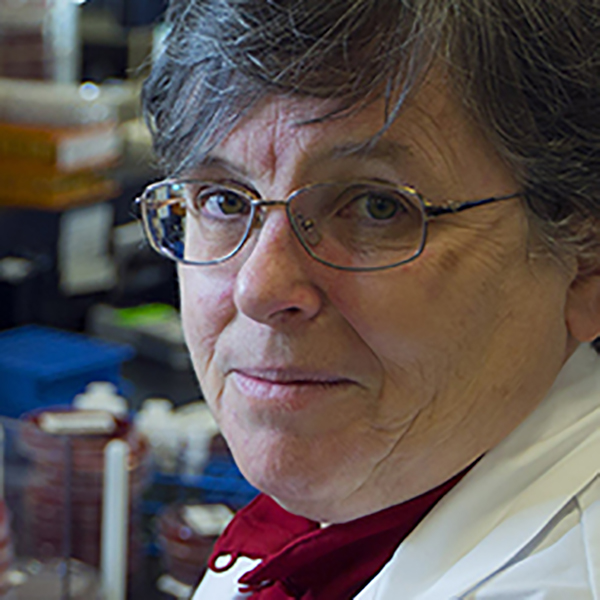
Existe-t-il des taux d’anticorps post-vaccination en corrélation avec la protection contre la COVID-19? (AB-Protect)
Allison McGeer, Sinai Health System
Cette étude vise à comprendre s’il existe un corrélat de protection d’anticorps associé à la vaccination contre la COVID-19 et ses variants. Le projet complète les études existantes sur l’efficacité des vaccins et se concentre sur l’identification des personnes qui développent la COVID-19 malgré une vaccination, afin de mieux comprendre leurs niveaux d’anticorps.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 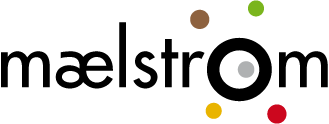

Réseau canadien d’intervention rapide dans les services d’urgence pour la COVID-19 : efficacité du vaccin dans le monde réel et durée de la protection dans des populations particulières
Corinne Hohl, Université de la Colombie-Britannique
À l’aide d’un réseau existant dans huit provinces, cette étude crée une plateforme nationale d’évaluation des vaccins afin de recueillir des données sur le statut vaccinal et de répondre aux questions sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. L’équipe évalue l’efficacité du vaccin et la durée de la protection dans les gens qui reçoivent couramment des soins dans les services d’urgence.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 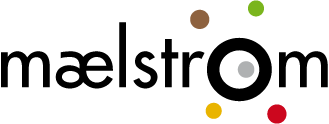

Surveillance sentinelle des effets secondaires graves suivant l’immunisation et évaluation de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour la prévention des effets graves chez les adultes canadiens hospitalisés : Une étude du Réseau de surveillance des cas graves SOS (Serious Outcomes Surveillance) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)
Shelly McNeil, Nova Scotia Health Authority
Dans le cadre de cette étude, le réseau SOS effectue une surveillance renforcée de la COVID-19 en fournissant une description détaillée des caractéristiques cliniques, de la gravité de la maladie et des effets chez des adultes hospitalisés pour la COVID-19. Les membres du réseau fournissent également aux responsables de la santé publique des renseignements essentiels concernant des effets secondaires graves suivant l’immunisation.
Sommaire Résultats Site web de l’étude Voir l’étude sur 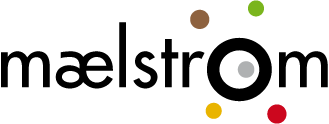
Shelly McNeil
Shelly McNeil, M.D.
Professeure de médecine, Université Dalhousie
Chef, Division des maladies infectieuses, Nova Scotia Health
Coordonnées
Shelly.mcneil@nshealth.ca
Mots-clés
Maladies infectieuses
Vaccin
Efficacité du vaccin
Domaines de recherche
Fardeau des maladies évitables par la vaccination chez les adultes, avec une attention particulière pour l’impact sur les personnes âgées, notamment la fragilité
Efficacité des vaccins pour la prévention des maladies graves
Publications
Foley M.K., Searle S.D., Toloue A., Booth R., Falkenham A., Falzarano D., Rubino S., Francis M.E., McNeil M., Richardson C., LeBlanc J., Oldford S., Gerdts V., Andrew M.K., McNeil S.A., Clarke B., Rockwood K., Kelvin D.J., Kelvin A.A. Centenarians and extremely old people living with frailty can elicit durable SARS-CoV-2 spike specific IgG antibodies with virus neutralization functions following virus infection as determined by serological study. EClinicalMedicine. Juil. 2021;37:100975. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100975. Epub 27 juin 2021. PMID:34222846; PMCID: PMC8235995.
Andrew M.K., MacDonald S., Godin J., McElhaney J.E., LeBlanc J., Hatchette T.F., Bowie W., Katz K., McGeer A., Semret M., McNeil S.A. Persistent Functional Decline Following Hospitalization with Influenza or Acute Respiratory Illness. J Am Geriatr Soc. Mars 2021;69(3):696-703. doi: 10.1111/jgs.16950. Epub 8 déc. 2020.
PMID: 33294986; PMCID: PMC7984066.
Andrew M., Searle S.D., McElhaney J.E., McNeil S.A., Clarke B., Rockwood K., Kelvin D.J. COVID-19, frailty and long-term care: Implications for policy and practice. J Infect Dev Ctries. 31 mai 2020;14(5):428-432. doi: 10.3855/jidc.13003. PMID:32525825.
Surveillance sentinelle des effets secondaires graves suivant l'immunisation et évaluation de l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour la prévention des effets graves chez les adultes canadiens hospitalisés : Une étude du Réseau de surveillance des cas graves SOS (Serious Outcomes Surveillance) du Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (RCRI)
Le Réseau de surveillance des cas graves SOS, qui fait partie du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), a été créé à l’origine pour la surveillance de l’influenza (grippe). Le réseau fournit à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) une compréhension exhaustive des résultats obtenus chez les adultes hospitalisés pour la grippe, l’impact de différentes souches de grippe et une plateforme pour l’évaluation continue de l’efficacité des vaccins contre la grippe dans la prévention des effets graves. Le Réseau SOS travaille maintenant sur la COVID-19 et vise à fournir des renseignements détaillés et en temps réel sur le fardeau de la COVID-19 menant à l’hospitalisation chez les adultes canadiens.
Grâce à cette étude, le Réseau SOS effectue une surveillance renforcée en laboratoire de la COVID-19 et fournit aux responsables de la santé publique une description détaillée des caractéristiques cliniques, de la gravité de la maladie et des effets chez des adultes hospitalisés pour la COVID-19. Nous fournissons également aux responsables de la santé publique des estimations continues de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans la prévention des hospitalisations et des décès dans un éventail de populations prioritaires, ainsi que des renseignements essentiels concernant les effets secondaires graves suivant l’immunisation et les événements indésirables présentant un intérêt particulier.
Le réseau SOS est composé de 12 sites dans cinq provinces (Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique) représentant environ 5 800 lits de soins actifs pour adultes.
Cette étude fournira des renseignements essentiels sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde réel et contribuera à une meilleure compréhension de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour la prévention des effets graves, y compris l’hospitalisation et le décès chez les adultes, en particulier chez les adultes âgés et fragiles et ceux qui présentent des comorbidités sous-jacentes, y compris des maladies auto-immunes, et les personnes immunodéprimées.
Résultats : Surveillance sentinelle des effets secondaires graves suivant l'immunisation et évaluation de l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour la prévention des effets graves chez les adultes canadiens hospitalisés : Une étude du Réseau de surveillance des cas graves SOS (Serious Outcomes Surveillance) du Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (RCRI)
Corinne Hohl
Corinne Hohl
Professeure agrégée, Département médecine d’urgence, Université de la Colombie-Britannique
Médecin traitant, Vancouver General Hospital
Coordonnées
corinne.hohl@ubc.ca
Mots-clés
Registre COVID-19, registre, études observationnelles, efficacité, médecine d’urgence
Intérêts de recherche
Harmoniser la collecte de données sur les facteurs de risque, les traitements et les résultats à court et à long terme (y compris les résultats rapportés par les patients) chez les patients ayant un cas de COVID-19 suspecté ou confirmé, afin de permettre la réalisation d’études nationales d’observation sur la COVID-19.
Élaborer, valider et perfectionner les instruments de décision clinique afin d’aider les cliniciens à utiliser les tests de diagnostic, à prédire les résultats de la COVID-19 pour orienter les conversations sur le niveau de soins et le triage des patients, et à assurer la sécurité des patients qui quittent les services d’urgence.
Évaluer l’efficacité réelle et la durée de protection des vaccins contre la COVID-19 tels qu’ils sont administrés au Canada, y compris dans des populations spécifiques, et avec des calendriers de vaccination mixtes et des secondes doses différées.
Publications
Document sur les méthodes du CCEDRRN
DOI:10.9778/cmajo.20200290
Comparing of treatments and patient outcomes across Canada between wave 1 and wave 2:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.30.21261288v1
Clinical decision rule that allows emergency clinicians to identify COVID-19 risks at triage to guide the decision to test for COVID: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.15.21260590v2
Élaboration et validation d’une règle de décision clinique permettant aux médecins des urgences et des unités de soins intensifs de déterminer le risque de mortalité à l’arrivée avant que des décisions liées à l’intubation ne soient prises, afin de guider la prise de décision partagée autour du statut de code et du triage des patients :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261283v1
Réseau canadien d’intervention rapide dans les services d’urgence pour la COVID-19 : efficacité du vaccin dans le monde réel et durée de la protection dans des populations particulières
Le réseau Canadian COVID-19 Emergency Department Rapid Response Network (CCEDRRN) (Réseau canadien d’intervention rapide dans les services d’urgence pour la COVID-19) a été mis sur pied en 2020 et travaille à l’harmonisation des données sur les patients testés pour la COVID-19 dans 50 services d’urgence (SU) de huit provinces canadiennes. Plus de 130 000 patients sont inscrits dans le registre. En utilisant ce réseau et cette infrastructure existants, nous créons une plateforme nationale d’évaluation des vaccins en partenariat avec les partenaires provinciaux de la santé publique afin de recueillir des données sur le statut vaccinal et de répondre aux questions sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19.
Notre étude, intitulée Canadian COVID-19 Emergency Department Rapid Response Network: Real-World Vaccine Effectiveness and Duration of Protection in Special Populations (Réseau canadien d’intervention rapide dans les services d’urgence pour la COVID-19 : efficacité du vaccin dans le monde réel et durée de la protection dans des populations particulières), a pour objectifs d’évaluer l’efficacité des vaccins et la durée de cette protection dans les populations qui reçoivent généralement des soins dans les urgences pour des cas de COVID-19 symptomatiques et graves, en mettant l’accent sur des groupes spécifiques tels que les personnes appartenant à des communautés racisées ou marginalisées. Nous recueillons des données cliniques, démographiques et sociales détaillées en examinant les dossiers des hôpitaux et en effectuant des appels téléphoniques de suivi. Les nombreuses méthodes de collecte de données nous permettent d’évaluer la qualité des données sur les vaccins et de recueillir des renseignements sur la race, l’origine ethnique, le sexe et d’autres déterminants de la transmission et du risque de la COVID-19 qui ne sont pas saisis dans d’autres ensembles de données.
Nos évaluations prennent en compte l’administration d’une seule ou de deux doses d’un vaccin, les doses de rappel et le mélange de vaccins de différents fabricants. Nous cherchons également à savoir combien de temps dure la protection vaccinale contre les formes symptomatiques de la COVID-19 dans la population générale par rapport à des groupes de population spécifiques.
Nos recherches complètent d’autres projets de surveillance des vaccins au Canada et les données que nous recueillons sur un vaste éventail de patients et de gravité de la maladie nous permettront de répondre aux questions prioritaires afin de guider les décisions de santé publique en matière de vaccination.
Réseau canadien d’intervention rapide dans les services d’urgence pour la COVID-19 : efficacité du vaccin dans le monde réel et durée de la protection dans des populations particulières
Allison McGeer
Allison McGeer, M.D.
Professeure, Université de Toronto
Experte-conseil en maladies infectieuses, Sinai Health System
Mots-clés
Immunisation chez l’adulte
Épidémiologie
Soins de longue durée
Domaines de recherche
Mes travaux de recherche sont axés sur la prévention des infections nosocomiales, les approches épidémiologiques de réduction de la charge de morbidité des maladies infectieuses et l’immunisation chez l’adulte.
Publications
Abe KT, Li Z, Samson R, Samavarchi-Tehrani P, Valcourt EJ, Wood H, et al. A simple protein-based surrogate neutralization assay for SARS-CoV-2. JCI insight. 2020;5(19).
Isho B, Abe KT, Zuo M, Jamal AJ, Rathod B, Wang JH, et al. Persistence of serum and saliva antibody responses to SARS-CoV-2 spike antigens in COVID-19 patients. Science immunology. 2020;5(52).
Kohler PP, Kahlert CR, Sumer J, Flury D, Güsewell S, Leal-Neto OB, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies among Swiss hospital workers: Results of a prospective cohort study. Infection control and hospital epidemiology. 2020:1-5.
Law JC, Koh WH, Budylowski P, Lin J, Yue F, Abe KT, et al. Systematic Examination of Antigen-Specific Recall T Cell Responses to SARS-CoV-2 versus Influenza Virus Reveals a Distinct Inflammatory Profile. Journal of immunology (Baltimore, Md : 1950). 2021;206(1):37-50.
Existe-t-il des taux d’anticorps post-vaccination en corrélation avec la protection contre la COVID-19? (AB-Protect)
Lors de la mise au point de nouveaux vaccins pour une maladie particulière, l’objectif initial est de déterminer si le vaccin protège contre l’infection. Parallèlement à ces études, les chercheurs cherchent également à identifier des marqueurs appelés « corrélats de protection », c’est-à-dire des signes mesurables indiquant qu’une personne (ou un autre hôte potentiel) est immunisée, en ce sens qu’elle est protégée contre l’infection ou le risque de contracter la maladie. Pour de nombreux virus, les anticorps servent de corrélat de protection, mais ils ne sont pas le seul élément à prendre en compte pour déterminer si une personne est entièrement immunisée. Une fois que les corrélats de protection sont établis, de nouveaux vaccins ou des doses de rappel de vaccins peuvent être autorisés si le vaccin augmente suffisamment les corrélats de protection d’une personne pour la protéger, plutôt que de nécessiter des essais cliniques de grande envergure pour prouver l’efficacité contre la maladie. Déterminer ces corrélats de protection est donc essentiel pour la mise au point continue de nouveaux vaccins et pour les décisions concernant la nécessité de doses de rappel de vaccins. Notre étude vise à comprendre s’il existe un corrélat de protection d’anticorps associé à la vaccination contre la COVID-19 et ses variants.
Notre projet de recherche complète les études existantes sur l’efficacité des vaccins et se concentre sur l’identification des personnes qui développent la COVID-19 malgré une vaccination. Nous recueillons des données et des échantillons de sang veineux (une prise de sang standard à l’aide d’une aiguille) ou de goutte de sang séché auprès de patients hospitalisés ou vivant dans la communauté qui sont infectés par la COVID-19 afin de déterminer leur taux d’anticorps. Nous comparons ces patients à d’autres personnes vaccinées, y compris les membres de leur famille, qui ont été exposées à la COVID-19, mais n’ont pas développé de maladie. Nous comparons les titres d’anticorps post-vaccination deux à quatre semaines après la dernière dose et six mois plus tard si possible.
Nous examinons les données tous les mois afin d’identifier les résultats qui devraient être communiqués aux agences et organisations de santé publique. Nous recherchons également d’autres études sur les corrélats de protection au Canada et ailleurs afin de déterminer si la combinaison des résultats peut produire des données significatives plus tôt.
Résultats: Existe-t-il des taux d’anticorps post-vaccination en corrélation avec la protection contre la COVID-19? (AB-Protect)
Julie Bettinger
Julie Bettinger, Ph. D., MPH
Professeure, Vaccine Evaluation Center, Département de pédiatrie, Université de la Colombie-Britannique
Chercheuse principale, Réseau national canadien d’évaluation pour la sécurité des vaccins (CANVAS) du RCRI
Directrice du centre de données, Programme canadien de surveillance active de la vaccination (IMPACT)
Mots-clés
Sécurité des vaccins, taux d’immunisation
Domaines de recherche
Sécurité des vaccins et maladies évitables par la vaccination
Attitudes et croyances concernant l’adoption et l’utilisation de la vaccination
Le Réseau national canadien pour l’innocuité des vaccins (CANVAS)
Les vaccins contre la COVID-19 ont été testés dans le cadre d’essais cliniques afin de prouver qu’ils sont sûrs pour les humains, mais le fait de passer à une utilisation généralisée des vaccins dans la population générale rend indispensable la collecte de données sur tout événement ou réaction indésirable que les gens pourraient ressentir. Depuis 2009, le Réseau national canadien pour l’innocuité des vaccins (CANVAS), qui fait partie du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), effectue une surveillance active de l’innocuité des vaccins contre la grippe saisonnière et d’autres vaccins afin de fournir des données aux autorités de santé publique. En utilisant ce cadre existant, le réseau CANVAS surveille l’innocuité des vaccins contre la COVID-19 dans l’ensemble du Canada en déterminant la fréquence des problèmes de santé survenant après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19.
Cette étude suit environ 1 000 000 de personnes qui ont été vaccinées avec des vaccins contre la COVID-19. Les participants viennent de la Colombie-Britannique, du Yukon, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Une cohorte de participants pédiatriques âgés de 5 à 19 ans est intégrée à cette étude. Ils répondent à de courts sondages en ligne huit jours après chaque dose de vaccin contre la COVID-19 et six mois après leur dernière dose. Les chercheurs les interrogent sur les incidents de santé qu’ils ont vécus dans la semaine suivant la vaccination ainsi qu’entre les doses afin d’identifier tout nouveau problème de santé ou l’exacerbation d’une condition existante qui empêche les activités quotidiennes ou les oblige à manquer le travail ou l’école, ou à consulter un médecin. L’étude comprend un groupe témoin de 50 000 personnes non vaccinées afin de comparer les effets indésirables signalés par un groupe non vacciné.
Cette recherche fournira des renseignements importants sur la sécurité des vaccins et contribuera à la planification des programmes de vaccination de santé publique en cours.
Résultats : Le Réseau national canadien pour l’innocuité des vaccins (CANVAS)
Alexander Doroshenko
Alexander Doroshenko
Professeur agrégé, Faculté de médecine et de dentisterie et professeur adjoint, École de santé publique, Université de l’Alberta
Médecin hygiéniste, Alberta Health Services
Coordonnées
adorohse@ualberta.ca
Mots-clés
Contrôle des maladies transmissibles
Immunisation
Maladies évitables par la vaccination
Programmes et politiques de santé publique
Surveillance
Évaluation
Réponse aux épidémies
Modélisation mathématique
Intérêts de recherche
Épidémiologie des maladies transmissibles et trajectoires des éclosions
Évaluation des interventions et des mesures de réponse pour contrôler les maladies transmissibles
Maladies évitables par la vaccination et innocuité des vaccins
Systèmes de surveillance de la santé publique
Publications
Doroshenko A., The Combined Effect of Vaccination and Nonpharmaceutical Public Health Interventions-Ending the COVID-19 Pandemic, JAMA Netw Open, 2021 Juin 1;4(6):e2111675
Caractérisation de l’épidémiologie de la sécurité du vaccin contre la COVID-19 et détection des signaux de sécurité pour les effets secondaires après l’immunisation en Alberta
Les vaccins contre la COVID-19 approuvés se sont tous avérés sûrs lors des essais cliniques. Etant donné le nombre sans précédent de personnes qui reçoivent ces vaccins récemment approuvés, il est essentiel de recueillir des données sur tout effet secondaire associé aux vaccins afin d’orienter la politique publique. En Alberta, les professionnels de la santé doivent signaler tout événement indésirable à la santé publique après avoir administré des vaccins. Ces données sont ensuite analysées pour déterminer la fréquence de certains effets secondaires au fil du temps et si certains groupes connaissent des événements plus fréquents ou plus graves.
Cette étude, intitulée Characterization of COVID-19 vaccine safety epidemiology and safety signal detection for adverse events following immunization in Alberta (Caractérisation de l’épidémiologie de la sécurité du vaccin contre la COVID-19 et détection des signaux de sécurité pour les effets secondaires après l’immunisation en Alberta), vise à renforcer la capacité existante du système de santé publique de la province à consigner et à étudier les événements indésirables après la vaccination. Les chercheurs travaillent en partenariat avec les services de santé publique pour garantir la production rapide de rapports complets et si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, nous menons des entretiens de suivi ou examinons les dossiers médicaux. Ils utilisent également des méthodes statistiques et épidémiologiques pour rechercher des signaux, c’est-à-dire si certains événements de santé se produisent à un rythme plus fréquent.
Cette étude porte spécifiquement sur les événements indésirables chez des personnes telles que des Autochtones et des personnes issues de milieux économiquement vulnérables, pour lesquelles il peut être difficile d’obtenir des renseignements fiables. Les chercheurs s’intéressent également à des événements qui n’ont peut-être pas eu lieu lors d’essais cliniques pour la COVID-19, mais qui pourraient être associés aux vaccins contre la COVID-19.
Il est très important de faire démonstration de la sécurité des vaccins contre la COVID-19 pour renforcer la confiance du public dans les programmes d’immunisation. Ce groupe de recherche communiquera les résultats de l’étude à tous les intervenants de la santé publique et au public de manière transparente et culturellement appropriée.
Dr Marc Germain
Dr Marc Germain
Vice-président, affaires médicales et innovation, Héma-Québec
Mots-clés
Transfusion, épidémiologie, maladies infectieuses
Domaines de recherche
Épidémiologie de la transfusion, maladies transmissibles par le sang
Publications
Approx 60
Suivi de la réponse immunitaire dans le contexte de la vaccination contre la COVID-19 – Mise en place d’une cohorte longitudinale de donneurs de plasma
Depuis le début de la pandémie, des chercheurs du monde entier se penchent activement sur des questions importantes concernant l’infection par la COVID-19 afin de soutenir les décideurs en matière de santé publique. Lors de la première vague de la pandémie en 2020, Héma-Québec a lancé une étude pour déterminer la prévalence des anticorps dans un échantillon de donneurs de sang. Avec l’approbation et la distribution des vaccins contre la COVID-19, Héma-Québec a lancé un autre projet visant à mettre en place une biobanque d’échantillons provenant de donneurs de plasma (le plasma est la partie liquide du sang, une fois toutes les cellules retirées; il contient de l’eau, des sels, des enzymes, des anticorps et d’autres protéines) pour étudier la réponse immunitaire à une vaccination ou à une infection.
Pendant plusieurs mois, tous les donneurs de plasma se présentant dans l’un de nos 10 sites permanents ont été invités à participer à cette étude, intitulée Suivi de la réponse immunitaire dans le contexte de la vaccination contre la COVID-19 – Mise en place d’une cohorte longitudinale de donneurs de plasma. Pour les donneurs qui acceptent de participer, nous prélevons un échantillon de plasma de 3 ml à la fin de leur séance, qui est ensuite mis en banque à des fins de recherche. Des données sur les événements de vaccination et d’infection sont également recueillies. Nous avons lancé une phase pilote en mars 2021, avant que les programmes de vaccination de la population contre la COVID-19 ne soient pleinement engagés, afin de nous assurer qu’une partie des échantillons étaient pré-vaccination. Le programme a ensuite été déployé dans tous les centres d’Héma-Québec en avril 2021.
Un grand nombre de nos donneurs donnent régulièrement du plasma, ce qui nous permet de recueillir des échantillons répétés et d’étudier la réponse à la vaccination ou à l’infection au fil du temps. Les échantillons collectés nous permettent de recueillir des renseignements avant et après la vaccination, et dans certains cas avant et après l’infection par la COVID-19, ce qui contribuera à mieux comprendre l’impact de la vaccination sur l’évolution de la pandémie. Nous prévoyons qu’au cours du projet, qui se poursuivra jusqu’en 2022, nous pourrons générer plus de 100 000 échantillons de plasma que les chercheurs et les partenaires d’Héma-Québec pourront étudier.
Jeff Kwong
Jeff Kwong
Professeur, Département de médecine familiale et communautaire et à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto
Médecin de famille, Toronto Western Family Health Team
Scientifique principal, ICES
Scientifique, Santé publique Ontario
Coordonnées
Jeff.kwong@utoronto.ca
Mots-clés
COVID-19, épidémiologie, vaccins, grippe, couplage de données, santé publique, médecine familiale
Domaines de recherche
Recherche épidémiologique sur les maladies infectieuses à l’aide de grandes bases de données reliées entre elles
Évaluation du vaccin contre la grippe (et maintenant la COVID-19) et des programmes de vaccination
Évaluation du fardeau sanitaire et économique des maladies infectieuses
Publications
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.24.21257744v1
Études post-commercialisation des vaccins contre la COVID-19 du Réseau de collaboration provinciale (RCP) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)
Les essais cliniques des vaccins contre la COVID-19 ont démontré l’innocuité et l’efficacité des vaccins, mais les personnes participant à ces essais se comptaient par dizaines de milliers et n’ont été suivies que pendant quelques mois. Comme pour tout vaccin, il est essentiel de continuer à surveiller l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19, car des millions de personnes reçoivent les vaccins dans le cadre de programmes de vaccination. Il est également important de surveiller la vaccination – combien de personnes sont vaccinées et à quel moment – afin d’éclairer la planification et l’évaluation continues des programmes de vaccination.
Le Réseau de collaboration provinciale (RCP) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) mène des études dans plusieurs provinces du Canada pour évaluer rapidement et rigoureusement la couverture, l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans la population en général et dans divers sous-groupes.
Cette étude, qui est en fait un groupe d’études intitulés Études post-commercialisation des vaccins contre la COVID-19 du Réseau de collaboration provinciale (RCP) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), fait appel à des bases de données reliées entre elles (données sur les vaccins, données de laboratoire et données administratives sur la santé) de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, ce qui représente 90 % de la population du Canada. Nos objectifs comptent l’estimation de la couverture vaccinale contre la COVID-19 (quelle marque de vaccin et quel nombre de doses) à plusieurs moments, en examinant les provinces individuellement, la population globale et des sous-groupes de population. Les chercheurs déterminent si les personnes vaccinées sont plus susceptibles que les personnes non vaccinées d’éprouver des effets secondaires associés aux vaccins et ils évaluent l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 dans la prévention des infections et des conséquences graves telles que l’hospitalisation et le décès. Cette étude examine également l’efficacité de différents vaccins et calendriers de dosage, l’impact d’une infection antérieure à la COVID-19 et la durée de la protection.
Les résultats aideront les gouvernements et les responsables de la santé publique à planifier les programmes de vaccination contre la COVID-19 en cours et à fournir au public des renseignements plus détaillés sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins.
Résultats : Études post-commercialisation des vaccins contre la COVID-19 du Réseau de collaboration provinciale (RCP) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)
Joanne Langley
Joanne Langley
Professeure de pédiatrie et de santé communautaire et professeure d’épidémiologie, Université Dalhousie
Titulaire de la chaire IRSC-GSK en vaccinologie pédiatrique, Université Dalhousie
Médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, IWK Health Centre
Directrice associée de l’unité d’évaluation clinique, Centre canadien de vaccinologie/Université Dalhousie/NSHA/IWK Health Centre
Responsable du Réseau d’essais cliniques du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI)
Directrice du département de maladies infectieuses pédiatriques, IWK Health Centre
Coordonnées
Joanne.langley@dal.ca
Mots-clés
Épidémiologie
Infections respiratoires/RSV
Immunisation
Vaccin
Intérêts de recherche
Épidémiologie et prévention vaccinale des infections respiratoires
Prise de décision en matière d’immunisation
Publications
Zhang K., Misra A., Kim P.J., Moghadas S.M., Langley J.M., Smieja M. « Rapid disappearance of influenza following the implementation of COVID-19 mitigation measures in Hamilton », Ontario. Can Commun Dis Rep. 2021;47(4):202-209. PubMed PMID: 34035666. DOI: 10.14745/ccdr.v47i04a04.
Moghadas S.M., Vilches T.N., Zhang K., Wells C.R., Shoukat A., Singer B.H., Meyers L.A., Neuzil K.M., Langley J.M., Fitzpatrick M.C., Galvani A.P. « The impact of vaccination on COVID-19 outbreaks in the United States ». Clin Infect Dis. 30 janv. 2021;ciab079. DOI: 10.1093/cid/ciab079. [Epub ahead of print]. PubMed ID: 33515252
Vilches T.N., Nourbakhsh S., Zhang K., Juden-Kelly L., Cipriano L.E., Langley J.M., Sah P., Galvani A.P., Moghadas S.M. « Multifaceted strategies for the control of COVID-19 outbreaks in long-term care facilities in Ontario », Canada. Prev Med. 18 avril 2021;148;106564. Diffusion en ligne avant l’impression. PubMed PMID: 33878351. DOI: 10.1016/j.ypmed.2021.106564.
Zhang K, Shoukat A, Crystal W, Langley JM, Galvani AP, Moghadas SM. Routine saliva testing for the identification of silent COVID-19 infections in healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol. 11 janv. 2021;1–17. doi: 10.1017/ice.2020.1413. [Epub ahead of print]. PubMed ID: 33427141.
Vilches T.N., Zhang K., Van Exan R., Langley J.M., Moghadas S.M. « Projecting the impact of a two-dose COVID-19 vaccination campaign in Ontario », Canada. Vaccine. 2021;39(17):2360-2365. PubMed PMID: 33812742
Immunogénicité et effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) avec des calendriers alternatifs de vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada : le « mélange » de la deuxième dose est-il sûr et immunogène?
Les vaccins contre la COVID-19 administrés dans le cadre des programmes de vaccination du Canada nécessitent tous deux doses, mais au début du déploiement de la vaccination, des retards de fabrication inattendus ont entraîné le report des expéditions de vaccins. Par conséquent, certaines provinces ont par la suite mis en place une approche de « mélange » permettant aux personnes de recevoir un vaccin contre la COVID-19 différent pour leur deuxième dose. De plus, certaines provinces ont par la suite mis en place une approche de « mélange » pour permettre aux personnes de recevoir un vaccin contre la COVID-19 différent pour leur deuxième dose. L’objectif de cette étude, intitulée Immunogénicité et effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) avec des calendriers alternatifs de vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada : le « mélange » de la deuxième dose est-il sûr et immunogène?, est de déterminer l’innocuité et l’efficacité de la combinaison de différents vaccins ainsi que les effets de différents intervalles de dosage sur l’immunité et l’innocuité.
Les chercheurs suivent les participants à l’étude dans les sites d’essais cliniques du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI) dans six provinces (Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Manitoba, Alberta et Colombie-Britannique). Ils étudient différentes combinaisons de vaccins pour deux calendriers de dosage différents : certains participants reçoivent leur deuxième dose à 28 jours, tandis que d’autres la reçoivent à 112 jours. Ils mesurent les réponses immunitaires des participants au moyen d’analyses sanguines périodiques. Les participants sont également suivis pour toute réaction après la vaccination qui pourrait affecter leur santé et leur bien-être.
Au fur et à mesure que d’autres vaccins seront disponibles au Canada, ils seront ajoutés à l’étude. Les résultats de cette recherche contribueront à fournir des données canadiennes sur l’utilisation des vaccins de la manière la plus efficace possible et à éclairer les recommandations et les décisions en matière de santé publique pour le déploiement continu des vaccins au Canada.
Résultats : Immunogénicité et effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) avec des calendriers alternatifs de vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada : le « mélange » de la deuxième dose est-il sûr et immunogène?
Robert Platt
Robert Platt
Professeur, Université McGill, et chercheur, Institut Lady Davis
Coordonnées
Robert.platt@mcgill.ca
Mots-clés
Biostatistique
Mégadonnées
Réseaux de recherche distribués
Intérêts de recherche
Méthodes statistiques pour l’analyse de données administratives et de dossiers médicaux électroniques
Inférence causale
Pharmacoépidémiologie
Épidémiologie de la grossesse et de la périnatalité
Meilleures pratiques pour les études en réseau distribué sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins
Le Réseau canadien pour l’étude observationnelle des médicaments (RCEOM) est un centre de coordination et un réseau de recherche pour les études observationnelles financées par le Réseau canadien sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments. La mission principale du RCEOM est d’utiliser les bases de données canadiennes et internationales par l’entremise d’un réseau distribué (un réseau informatique réparti sur différents réseaux) afin de fournir des réponses rapides aux questions concernant l’innocuité et l’efficacité des médicaments.
Ce projet, intitulé Best Practices for Distributed-Network Studies of Vaccine Safety and Efficacy (Meilleures pratiques pour les études en réseau distribué sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins), est axé sur l’élaboration et la mise en œuvre de solutions aux problèmes méthodologiques qui se posent dans les études relatives à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins. Afin de soutenir les organisations et les chercheurs, et en utilisant notre bibliothèque existante de méthodes pour l’innocuité et l’efficacité des médicaments, le RCEOM élabore des pratiques recommandées pour les études sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins dans les réseaux distribués. Cela comprend l’examen de la littérature actuelle sur le sujet, la mise au point de nouvelles méthodes et de progiciels d’analyse de données, selon les besoins, et le partage des nouvelles connaissances avec les utilisateurs concernés.
Les chercheurs se concentrent initialement sur trois volets : l’harmonisation entre les réseaux distribués (normalisation des données et programmes), l’analyse de la vie privée et les pratiques recommandées en matière de méta-analyse (analyse statistique combinant les résultats de plusieurs études). Ils sont en mesure de soutenir différents groupes menant des études de cette nature et de leur fournir des conseils méthodologiques en fonction des besoins.
Karina Top
Karina Top
Professeure agrégée, Université Dalhousie
Consultante en maladies infectieuses pédiatriques, IWK Health
Coordonnées
Karina.top@dal.ca
Mots-clés
Vaccins
Événements indésirables après la vaccination
Épidémiologie
Maladies infectieuses
Pédiatrie
Intérêts de recherche
Surveillance de l’innocuité des vaccins
Gestion clinique des patients ayant subi des effets indésirables suite à une vaccination
Sécurité et efficacité des vaccins chez les patients immunodéprimés
Innocuité des vaccins durant la grossesse
Optimisation de l’immunisation contre la COVID-19 chez les patients présentant des effets secondaires suivant l’immunisation et les patients immunodéprimés dans le réseau de cliniques spécialisées en immunisation
Le succès des campagnes de vaccination massive contre la COVID-19 dépend de l’évaluation continue du profil de sécurité et de l’efficacité des vaccins. Une partie du travail d’évaluation de l’innocuité des vaccins consiste à étudier les effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) qui surviennent rarement.
Le réseau des cliniques spécialisées en immunisation (CSI) du Réseau canadien de recherche sur l’immunisation a été créé en 2013 et compte actuellement 17 sites couvrant 10 provinces. Le Réseau de CSI est une composante essentielle du système canadien de sécurité des vaccins et il a élaboré des protocoles standardisés pour l’évaluation, la gestion et le suivi des patients présentant des ESSI.
Cette étude, intitulée Optimizing COVID-19 immunization in patients with adverse events following immunization and patients with immunosuppression in the Special Immunization Clinical Network (Optimisation de l’immunisation contre la COVID-19 chez les patients présentant des effets secondaires suivant l’immunisation et les patients immunodéprimés dans le réseau de cliniques spécialisées en immunisation), vise à aider les organismes de santé publique à normaliser l’évaluation et la prise en charge des patients présentant des ESSI inattendus et graves aux vaccins contre la COVID-19. L’étude déterminera la sécurité de l’administration des doses ultérieures et le risque de récurrence des ESSI, ainsi que les facteurs de risque d’allergie au vaccin contre la COVID-19.
Les patients qui présentent un effet secondaire à la suite de la vaccination contre la COVID-19 peuvent être orientés vers le réseau de CSI par un prestataire de soins de santé pour une évaluation plus approfondie, qui peut inclure des antécédents médicaux détaillés, des examens supplémentaires tels que des tests cutanés d’allergie et un traitement tel qu’une revaccination supervisée pour ceux qui présentent des réactions allergiques graves. Le Réseau des CSI peut également coordonner l’orientation vers d’autres spécialistes pour aider à confirmer le diagnostic.
Les chercheurs communiquent leurs résultats aux autorités de santé publique et aux prestataires de soins de santé afin de les aider à fournir des solutions à d’éventuels problèmes en matière de sécurité et à formuler des recommandations relatives aux vaccins contre la COVID-19 pour les personnes ayant éprouvé un effet secondaire.
La sécurité des vaccins contre la COVID-19
Results: SeroTracker
Voir nos autres études de recherche financées
Voir nos autres études de recherche financées
![]() Variants préoccupantset variants préoccupants
Variants préoccupantset variants préoccupants